 |
| Jean Cocteau, La Belle et la Bête, André Paulvé, 1946, 57:41 |
Faire le choix de l’adaptation d’un conte pour enfants, au sortir du traumatisme collectif de la Seconde Guerre Mondiale, peut apparaître comme un déni, ou du moins un besoin vital de régression. Le poète le formule ainsi, lors d’une entrevue avec Le courrier de l’Étudiant à l’occasion de la sortie du film :
« Avec « La Belle et la Bête », je n’ai eu qu’une préoccupation, être d’accord avec le style Conte de Fées, ceux-ci représentant pour moi, tels que les ont écrits Perrault, Mme d’Aulnoy, Mme Leprince de Beaumont, la véritable mythologie française. »[1]
D’un mythe de l’enfance à un mythe de la France
Le conte de La Belle et la Bête s’inscrit dans la mythologie personnelle du réalisateur, au même titre que le mythe d’Œdipe dans sa pièce La Machine infernale (1932), de celui d’Orphée dans son film éponyme (1950), ou encore de la légende amoureuse de Tristan et Iseult dans L’Éternel Retour (1943). Tout se passe comme si son travail de réécriture n’avait pas été entaché par 5 ans de guerre. Pour autant, on peut voir dans le choix du féérique une volonté saillante, presque patriotique, de réenchanter la nation, en faisant de ce mythe intime lié à l’enfance celui de la France toute entière.
L’histoire de La Belle et la Bête, si elle a des origines obscures, comme tous les contes issus d’une tradition orale et populaire, peut être datée dans sa forme contemporaine de 1756. Mme Leprince de Beaumont, inscrite dans une longue tradition de réécriture, emprunte ce conte à Mme de Villeneuve (1740), qui s’inspire elle-même largement d’Amour et Psyché d’Apulée (IIe siècle avant J.-C.). C’est donc à juste titre que Cocteau cite Mme Leprince de Beaumont, dont il reprend la trame remaniée par une préceptrice qui avait pour visée l’éducation de jeunes filles de l’aristocratie anglaise. Son Magasin des enfants, véritable traité d’éducation au temps des Lumières, comprend un ensemble de leçons entrecoupées de contes, qui permettent un enseignement par le plaisir. Ce best-seller de l’époque, qui a traversé tout le XIXe siècle, constitue un socle commun de l’enfance pour tous les français.
En plus d’inviter le spectateur à retrouver l’innocence de son enfance volée par la guerre, le choix de ce conte intrinsèquement français est aussi un acte de résistance. Acte de résistance a posteriori, certes, mais qui vient en réalité poursuivre et consolider la lutte de ceux de la première heure. Sur le plan littéraire et métaphorique, la Bête représente les instincts les plus bas de l’humanité et de la guerre toute entière : elle a une fonction cathartique. La métamorphose finale de la Bête en prince serait une allégorie de la renaissance nationale, mais aussi du cinéma français. En effet, en 1945, les producteurs Gaumont puis André Paulvé placent leur espoir dans cette adaptation, qui se pose en concurrence directe des productions Disney. Dans le contexte des accords Blum-Byrns signés le 28 mai 1946, les productions américaines sont amenées à occuper une place de plus en plus écrasante dans la distribution française. Mais le cœur des spectateurs est encore à conquérir.
Jean Cocteau vit dès lors la production de ce film comme un enjeu national, d’autant plus que le poète n’a pas témoigné un engagement véritable pendant la guerre, en proie avec ses propres démons et en cure de désintoxication. « Sartre sait ce que j’en pense. Mon engagement est de me perdre jusqu’à l’extrémité la plus inconfortable de moi-même. »[2] Aussi, l’engagement devient poétique :
« Nous nous sommes faits du mauvais sang et ce mauvais sang désagrège. Cinq ans de haine, de craintes, de réveils en plein cauchemar. Cinq ans de honte et de boue. Nous en étions éclaboussés, barbouillés jusqu’à l’âme. Il fallait tenir. Attendre. C’est cette attente nerveuse que nous payons cher. C’est cette attente qu’il importe de rattraper quels que soient les obstacles. La France doit briller coûte que coûte. »[3]
Trinité Cocteau-Marais-Bête, face à la poésie incarnée par la Belle
La première image de la séquence liminaire présente, au premier plan, Jean Marais de dos, assis sur un divan, un chien à ses pieds, et observant Jean Cocteau lui tournant le dos lui-même, effaçant un tableau pour y inscrire le nom de son acteur fétiche et amant. La trinité Cocteau-Marais-Bête est dès lors annoncée : le poète, l’acteur et la Bête sont une même et seule personne, qui tente de séduire la muse de la poésie incarnée par la Belle, sous sa forme la plus vulnérable. Cette trinité se retrouve dans le scénario : Jean Marais, premier nom apparaissant au générique, que l’acteur lui-même vient effacer, incarne tout à la fois la Bête, Avenant et le prince.
« Avenant, la Bête et le prince comme trois facettes d’un fantasme poétique, comme la volonté de délivrer le moi d’une dimension obscène afin qu’advienne, dans sa pureté rayonnante, un Idéal du moi, bien nommé Avenant, dont la transfiguration en prince indique la sublimation accomplie. Par l’alchimie de l’amour, le laid bestial, sexuel donc, est expurgé, réalisant la métamorphose d’un soi transcendé. Ainsi libéré, le soi brillerait de son être de vérité décantée de toute souillure. »[4]
Marie Jejcic fait une lecture psychanalytique de l’œuvre, en tentant de comprendre les causes de l’étrange eczéma qui ronge le poète durant le tournage du film, dont il fait part dans son Journal, qui serait lié au « soi symptomatique », tel que développé par Lacan. Cette lecture psychanalytique est renforcée par la souffrance qu’endure Jean Marais lui-même lors de sa transformation en Bête : parfois jusqu’à cinq heures de maquillage, de la tête aux mains griffues, l’acteur vit une expérience complète de transformation bestiale. Jean Cocteau refuse la pose d’un masque, qui amoindrirait la prestation de son acteur fétiche. Le maquillage permet de révéler, derrière ses artifices, le véritable visage de l’acteur, et notamment son regard perçant.
Dans la trinité qui unie Avenant, Prince et Bête, le premier serait le poète brusquant la poésie, contre la passivité de la Bête subissant sa bestialité. Cette dernière « au lieu de plaire […] effraye. Cela explique la lutte qu’on mène contre lui. »[5] Cocteau, portant littéralement un masque de douleur pendant le tournage, s’identifie à la Bête : « Ne pas me mêler de poésie. Elle doit venir d’elle-même. Son seul nom prononcé bas l’effarouche. »[6] Comme la Bête, le poète doit mourir pour renaître de ses cendres, grâce au regard poétique amoureux de la Belle. La lutte interne qui divise Cocteau apparaît contraire à la volonté première, encouragée par les producteurs, d’un film « grand public » de réenchantement national… Si pour le poète cette part intime ne constitue pas un obstacle à l’universel, la réception de son temps ne sera pas aussi unanime sur la question.
Poétique féérique au cinéma
Au-delà du thème de la réécriture, la problématique littéraire est prégnante dans le cinéma de Cocteau. Poète avant d’être metteur en scène, conte littéraire avant d’être film : comment retranscrire la poétique du langage et de l’image féérique au cinéma ? Si le merveilleux se prête aisément à la mise en scène, comme en témoigne l’adaptation du conte par Marmontel en Opéra-Comique en 1771, avec ses trucages destinés à éblouir le spectateur, le cinéma offre encore une forme renouvelée du genre.
Cocteau n’est pas seulement un poète qui a tourné des films, il a aussi produit un discours théorique sur le cinéma. Comme on peut le lire dans son Journal, son investissement dans la réalisation technique du film est total, de l’écriture du scénario, de la rédaction des dialogues, de la mise en scène en passant par le montage et la direction artistique. Tous ces éléments sont l’écriture du langage poétique, et ici féerique au cinéma. De plus, le cinéma empiète lui-même sur la poésie, si on pense aux nombreuses métaphores utilisées par le poète qui relèvent de cet univers : la caméra, la pellicule sensible, les bobines, le projecteur, la salle obscure, l’écran… Cinéma et littérature sont donc deux univers artistiques poreux, qui interagissent perpétuellement chez Cocteau.
« En faisant du cinéma, le poète s’arroge métaphoriquement sur ses personnages le même pouvoir que les dieux. La pratique avertie de cet art est donc manifestement pour Cocteau un jeu interdit qui ne manque pas de susciter des représailles. On s’en convaincra par la lecture du Journal d’un film, récit du long calvaire que fut le tournage de La Belle et la Bête. »[7]
La réalisation d’un film est une souffrance, mais aussi un moment de création artistique qui rapproche toute une équipe, devenant une seule et même personne.
« Clément, ma main droite ; Théria, ma main gauche ; Alekan, l’opérateur ; Tiquet ; son cameraman ; Lucile, ma script ; Bérard, lequel métamorphose les meubles et les étoffes ; Aldo, photographe, me donnent la sensation d’être mus par mes nerfs et par mes ondes. Je ne parle pas des artistes, Josette Day et Jean Marais en tête, à qui je m’efforce d’indiquer le moins possible, tellement l’atmosphère où ils baignent les inspire et les empêche de perdre leur route. »[8]
Cocteau metteur en scène souhaite que ses spectateurs soient aussi conscients du travail technique que représente la réalisation d’un film, et ne souhaite pas en gommer les artifices pur un effet de réel. Cette règle s’applique tout particulièrement pour le merveilleux qui se dégage du conte de fées. Cette artificialité assumée se retrouve dans le montage, inspirée des théories d’Eisenstein, qui prône la discontinuité dans le montage, contre son adversaire André Bazin qui opte pour la continuité. Pour ce dernier, le cinéma aurait pour unique vocation de reproduire le réel en respectant son ambiguïté immanente : le cinéma ne relève pas du monde des Idées. Ainsi, selon cette thèse, le montage doit respecter une règle essentielle de l’unité spatiale : « La spécificité cinématographique, saisie pour une fois à l’état pur, réside […] dans le simple respect photographique de l’unité de l’espace. »[9] . Dès lors, le montage a ses codes, des règles de conduite à respecter :
« Il faut que l’imaginaire ait sur l’écran la densité spatiale du réel. Le montage ne peut y être utilisé que dans des limites précises, sous peine d’attenter à l’ontologie même de la fable cinématographique. Par exemple, il n’est pas permis au réalisateur d’escamoter par le champ, contre-champ, la difficulté de faire voir deux aspects simultanés d’une action. »[10]
La discontinuité apparaît alors bien plus libre et propice à la création. Eisenstein affirme : « De mon point de vue, le montage n’est pas une idée composée de fragments mis à la suite, mais une idée qui naît du choc entre deux fragments indépendants. »[11]. Cocteau, dans cette lignée, n’hésite pas à confronter champ contre-champ le plan resserré de la Bête à celui de la Belle. La fabrique du film, dans son artifice, est dévoilée, et le faux raccord, absolument proscrit par Bazin, devient volontairement chez Cocteau une manifestation du merveilleux. Ce dévoilement est aussi l’objet de la rédaction du Journal, dont la curieuse impudeur étonne : « Personne ne raconte ses coulisses sauf vous. »[12]. Dans son article, Danielle Chaperon souligne :
« Le voyeurisme du spectateur ainsi encouragé par le cinéaste n’est pas anodin, et les interstices et autres intervalles ménagés par le montage entre les images sont, pareillement aux confidences, autant de serrures ouvertes sur cet univers du tournage qui correspond pour Cocteau à ce que serait le monde des fées par rapport aux personnages du conte. »[13]
Enfin, Cocteau aime le truquage voyant et artisanal, fidèle aux techniques archaïques de l’époque de Méliès. Loin des prouesses techniques Hollywoodiennes, le poète se plaît à montrer littéralement les ficelles transportant dans les airs de manière toute artificielle la Belle et son prince à la fin du conte.
Film grand public ou avant-gardiste, pourquoi choisir ?
L’éternelle division entre cinéma grand public et cinéma d’avant-garde oblige à situer un film dans l’un des deux camps. Pour celui-ci, les critiques de l’époque le place unanimement dans le second ; soulignant alors l’échec du projet initial, qui serait de manière caricaturale celui d’une surenchère au divertissement face à l’Empire Disney. « Je doute fort que La Belle et la Bête plaise beaucoup au grand public. », interroge Jean-Jacques Gautier dans Le Figaro[14]. Tout en reconnaissant la qualité plastique de l’œuvre, grâce au travail de René Clément et Alekan, le critique reproche au rythme du film une lenteur qui « donne l’impression de se traîner » et des réalisations techniques trop artisanales, pas suffisamment modernes. Henri Troyat porte un avis assez similaire :
« Jean Cocteau a eu tort de déflorer son film en laissant publier tant de photos sensationnelles de La Belle et la Bête. Car ces images merveilleuses forment, tout compte fait, l’essentiel de l’œuvre, et leur animation sur l’écran ne paraît plus indispensable. »[15]
Ces critiques considèrent que le travail de Cocteau reste à la surface plastique de l’image, à défaut de l’intrigue qui passerait au second plan. Jean Nery se montre particulièrement sévère à cet égard dans un article intitulé « La Belle et la Bête, Un film froid, plus inhumain qu’irréel, plus plastique qu’envoûtant. »[16]. Ce « demi-échec » de la part de Cocteau serait donc une coquille vide, faisant pâle figure face au cinéma d’animation de Walt Disney qui semble avoir remporté le pari de la féerie à l’écran :
« A la vérité, toutes les tentatives de cet ordre, pour mémoires qu’elles soient, semblent vaines et périmées après le miracle Walt Disney. Blanche-Neige et Pinocchio, sortis du néant, échappant aux lois communes, à la pesanteur, ont infiniment plus de réalité humaine. »
Le renouveau Disney s’impose comme une concurrence à l’œuvre féerique de Cocteau. Ce qui semble véritablement déranger ces critiques, c’est la posture et le personnage Cocteau : « L’anonymat des créateurs du dessin animé ne laisserait-il pas un champ plus libre à notre imagination ? »[17], mais aussi le cinéma d’avant-garde français qu’il incarne, jugé trop élitiste. Et cela ne manque pas : des critiques élogieuses émanent du camp des prescripteurs du bon goût culturel, venant confirmer l’assignation au film d’auteur.
En réalité, Cocteau offre une alternative salutaire, qui peut encore être suivie aujourd’hui, à l’heure des monstrueuses plateformes de streaming, Netflix, Amazon Prime, et l’excroissance Disney +. S’inscrire dans la postérité, sur le temps long, en respectant le caractère immuable de topoi universels ; assumer un cinéma d’auteur, en lui ôtant sa connotation élitaire, mais en réhabilitant la volonté d’un réalisateur d’inscrire dans son œuvre sa poésie, son souffle, son intimité ; actualiser une féérie héritée du texte énigmatique de brièveté de Mme Leprince de Beaumont, qui en dit plus par ses silences, des illustration oniriques de Gustave Doré qui ornaient les premiers livres pour les enfants, de la tradition d’un cinéma-spectacle qui n’a pas peur de dévoiler ses artifices en privilégiant l’artisanal aux effets techniques qui, sans cesse dépassés, vieillissent mal : telle doit être la posture alternative d’un cinéma véritablement enchanté, venant éblouir de sa pureté la niaiserie ambiante du cinéma-divertissement actuel, comme la Belle éblouit la Bête. Heureusement Cocteau a eu ses continuateurs, avec Jacques Demy en tête, où cinéma populaire ne vient pas s’opposer à l’inspiration créatrice singulière de son réalisateur, qui ne vient pas s'effacer derrière l'image de marque d'un producteur encombrant.
[1] Jean Cocteau interviewé par Le courrier de l’Étudiant le 15 avril 1946, « Jean Cocteau nous parle d’une Mythologie française ». Recueil d’articles de presse sur le film, numérisés par Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105226336/f17.item.zoom
[2] Jean Cocteau, Entretiens sur le cinématographe, Monaco, Édition du Rocher, 2003, p. 46.
[3] Jean Cocteau, La Belle et la Bête, Journal d’un film, Monaco, Édition du Rocher, 1989, p. 231.
[4] Marie Jejcic, « Singularité plurielle ou de l’autre en soi », Le Coq-héron, 2008, n°192, p. 88-95.
[5] Michael Popkin, « Cocteau’s Beauty and the Beast – The Poet as Monster », Literature Film Ouaterly, vol. 10, n°2, p. 100-109.
[6] Journal d’un film, op. cit., p. 17.
[7] Danielle Chaperon, « L’ange des intervalles : poétique du montage cinématographique chez Jean Cocteau », Cahiers de l’AIEF, 53, 2001, p. 351-366.
[8] Jean Cocteau, « Le travail de la Belle et la Bête », Carrefour, 1946.
[9] André Bazin, « Montage interdit », Qu’est-ce que le cinéma, Paris, Éditions du Cerf, 1985, p. 55.
[10] Ibidem, p. 56.
[11]
Eisenstein, « Dramaturgie de la forme filmiqu
e », [1929], cité dans
Jacques Aumont, Esthétique du film, Paris,
Nathan, 1994, p. 60.
[12] Jean Cocteau, Entretiens sur le cinématographe, Paris, Ramsay (Poche cinéma), 1986, p. 75.
[13] Danielle Chaperon, art. cit.
[14] Jean-Jacques Gautier, « La Belle et la Bête de Jean Cocteau », Le Figaro, 1946.
[15] Henri Troyat, « La critique des films : La Belle et le Bête », Cavalcade, 4 novembre 1946.
[16] Jean Nery, « La Belle et la Bête, un film froid, plus inhumain qu’irréel, plus plastique qu’envoûtant. », L’Écran.
[17] Bernard Zimmer, « La Belle et la Bête », La Bataille, 6 novembre 1946.
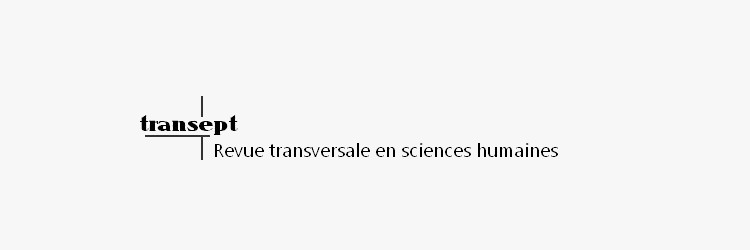



Intéressant. Merci !
RépondreSupprimerje confirme !
RépondreSupprimerArticle qui apporte un éclairage très intéressant sur ce film magnifique et donne des perspectives enthousiasmantes .
RépondreSupprimer